L’exposition Au temps de Klimt à la Pinacothèque de Paris est une véritable mine
d’informations sur un aspect essentiel de l'Art nouveau qui s'est développé à
Vienne au début du XXème siècle sous le nom de Sécession. Elle raconte entre
autres l’histoire des trois toiles allégoriques de Gustav Klimt ayant provoqué l’un
des plus grands scandales liés à l’art qui ont secoué l’Empire Austro-hongrois.
Mais au-delà de la controverse, cet épisode met en lumière le problème de la
liberté d’expression artistique et du rejet des compromis, notamment dans le
cadre des commandes officielles.
C’est en 1893 que Klimt est
sollicité par le ministre autrichien de l’éducation et de la culture pour
décorer le plafond de la salle des fêtes (Aula Magna) de l’université de
Vienne. Il doit également peindre trois toiles destinées aux facultés de
philosophie, de médecine et de jurisprudence. Klimt décide de représenter les
trois sciences sous forme d’allégories qui seront souvent modifiées. Une
première version de la toile Philosophie est présentée à la 7e
exposition de la Sécession Viennoise en mars 1900, mais la version définitive
date de 1907. L’artiste choisit de représenter la philosophie sous la forme mystérieuse
d'une sphinge aux contours flous, la tête perdue dans les étoiles, tandis
qu'autour d'elle se déroulent tous les cycles de la vie, de la naissance à la
vieillesse. A gauche, la "connaissance" revêt les traits d'une femme
fatale fixant de ses yeux froids et sombres le spectateur. Bien que cette toile
reçoive le premier prix à l’Exposition Universelle à Paris, elle fait l'objet
d'une critique sévère des autorités universitaires qui s'attendent à une
représentation classique et optimiste du sujet rendant hommage au progrès
scientifique, le thème initial étant « Le triomphe de la lumière sur
l’obscurité ». 87 membres de la faculté signent une pétition contre cette
toile, accusant Klimt de peindre des « idées confuses à travers des formes
confuses » et de ne rien connaître à la philosophie.
Le tableau Médecine, présenté en
1901, n’a pas davantage de succès et est jugé obscène : en raison de ses
nus « trop réalistes », Klimt est même accusé
de pornographie. Le scandale généré par cette toile prend une dimension
politique en provoquant un premier débat culturel dans le Parlement. Après
l’intervention du procureur, Klimt manque de peu d’être poursuivi en justice,
et la toile est censurée. Le ministre de l’éducation est le seul à défendre
l’artiste, et lorsque celui-ci est élu professeur à l’Académie des Beaux-Arts,
le gouvernement refuse de valider sa nomination. Klimt riposte avec Poisson
rouge qui met en scène une jeune femme montrant ses fesses et dont le titre
initial était A mes détracteurs.
 |
| Gustav Klimt, Poisson rouge (A mes détracteurs) |
Atteint par les critiques,
l’artiste choisit de présenter dans Jurisprudence (1903) une vision amère de la
justice. Trois silhouettes féminines qui sont des allégories de la Loi, de la
Justice et de la Vérité, condamnent et punissent le personnage central, un
homme saisi par les tentacules d’une pieuvre. Ces allégories rappelant les
Euménides de la mythologie grecque symbolisent l’idée de la « femme
fatale » qui deviendra, à travers des images de Salomé et de Judith, un
des leitmotivs de son œuvre. La critique
violente de la presse accuse Klimt
d'outrager l'enseignement et de vouloir pervertir la jeunesse. On lui reproche
ses peintures trop érotiques, et on s'interroge sur sa santé mentale et sur ses
crises de dépression. Face au scandale provoqué par ses toiles, Klimt
démissionne et refuse de mener la commande à son terme.
Les trois peintures ne furent
jamais accrochées à l’université et le gouvernement autrichien refusa même de
les voir présentées lors d’une exposition organisée en 1904 à Saint Louis, aux
Etats-Unis. Achetées par les collectionneurs, elles furent toutes saisies par
les nazis en 1938 et exposées une dernière fois en 1943, avant d’être emmenées au
château Immendorf où elles devaient être conservées. En mai 1945, les forces
allemandes en repli mirent le feu au château, détruisant ainsi les toiles et
d’autres œuvres de Klimt également présentes. Aujourd’hui, il n’en reste que
des photographies et quelques études conservées à l’Albertina de Vienne.

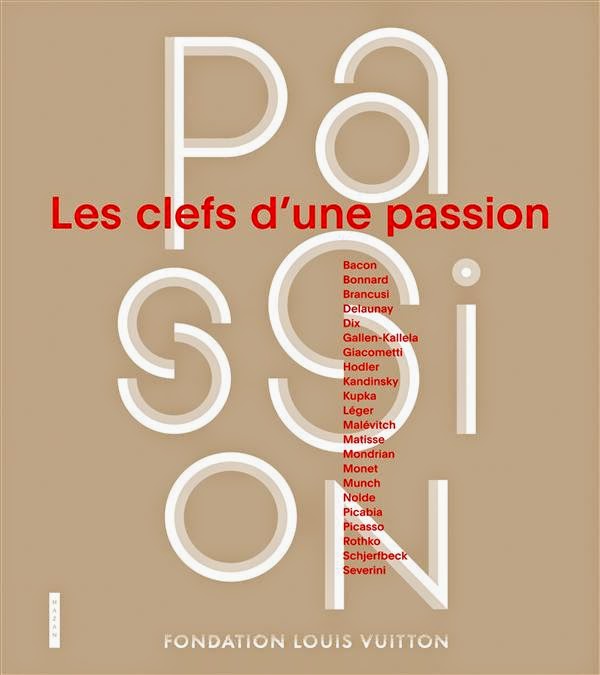



.jpg)


