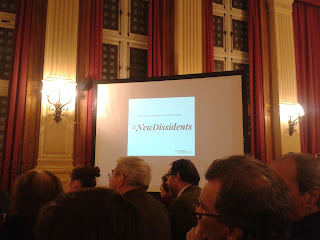Ce jour-là, la salle du Loft Roquette s’est vite révélée
trop petite pour accueillir tous les intéressés. Plus de 150 personnes sont
venues assister à la rencontre entre Vitaly Komar et
Piotr Pavlenski, deux
véritables légendes incarnant, chacun à sa façon, l’idée de résistance par les
moyens artistiques.
 |
| Vitaly Komar et Piotr Pavlenski au Loft Roquette, le 25 février 2017 |
Tous les deux, à des époques différentes, ont fui leur pays
natal, l’un volontairement, l’autre pour échapper aux poursuites pénales. Et
même s’ils ne se définissent pas forcément comme
dissidents, ils s’accordent
sur le rôle clé de la fameuse
Exposition
Bulldozer dans la genèse de l’art contemporain russe. Ce jour-là, le 15
septembre 1974, quelques artistes non-conformistes avaient exposé leurs œuvres
près du parc Belyayevo à Moscou, avant que celles-ci ne succombent aux coups de
bulldozers envoyés par les autorités. Fait emblématique, l’artiste Oscar
Rabine, l’organisateur principal de cette exposition, se trouvait dans la salle
du Loft Roquette pour assister à la rencontre des deux artistes : l’un le
fondateur de Sots Art résidant à New York depuis 1978 et connu pour sa longue
collaboration avec Alexandre Melamid, l’autre un « artiviste » et un
militant politique qui s’est fait un nom grâce à une série de performances
spectaculaires.
 |
| Vitaly Komar et Piotr Pavlenski au Loft Roquette, le 25 février 2017 |
C’est tout particulièrement l’exposition de 2007 Sots Art : Art Politique en Russie à la Maison
Rouge qui a permis de découvrir l’art de Vitaly
Komar en France. Certaines de ses œuvres font partie de l’exposition Kollektsia ! Art contemporain en URSS
et en Russie qui se déroule en ce moment au Centre Pompidou.
 |
| L'exposition Kollektsia! au Centre Pompidou, 2016-2017 |
Sur le modèle
du Pop Art américain nourri des images produites par la société de consommation
dans le contexte de la culture de masse, le Sots Art conçoit un art fondé sur
l’imagerie de la propagande soviétique. Sa fronde politique est basée sur des
manipulations ludiques d’une rhétorique du pouvoir destinée à soumettre
l’individu, sur l’appropriation des images et des slogans de la propagande pour
la rendre grotesque et libérer les consciences. Les armes qu’il utilise contre
de tels cultes sont le rire, la bouffonnerie, le travestissement et la
mystification.
 |
| "Sources et perspectives de l'art contemporain russe", ENSBA 2017 |
Vitaly Komar connaît bien l’œuvre d’Andy Warhol avec qui il
avait travaillé aux Etats-Unis. Mais ce jour-là il décide de rendre hommage à
ses confrères animaux, en présentant ses collaborations artistiques avec les
singes et les chiens. D’après l’artiste, les animaux voient les objets
invisibles à notre regard, faisant ainsi exploser le cadre de la perception humaine :
une vision décalée par rapport à la norme qui correspondrait tout à fait à la
définition du génie.
 |
| Vitaly Komar et Piotr Pavlenski au Loft Roquette, le 25 février 2017 |
Ce n’est sans doute pas un hasard que Komar est passionné
par le dualisme de son pays déchiré depuis toujours entre l’Europe et l’Asie.
Cette dualité semble omniprésente dans l’art russe qui depuis des siècles s’est
construit comme un dialogue avec le censeur. Ainsi pour comprendre cet univers,
il est indispensable de se mettre à la place du censeur, pour traquer sans
relâche d’innombrables métaphores dissimulées à travers
la langue d’Esope. Aux
yeux de Komar, le dualisme stylistique se manifeste tout particulièrement dans
les années 1920, lors du passage de l’avant-garde au socialisme réaliste. On le
retrouve dans la combinaison des éléments plats avec la profondeur, dans la mosaïque
byzantine associée à la peinture réaliste qui fait la particularité des icones
russes depuis Pierre le Grand. Mais la dualité se manifesterait également
dans la cohabitation des éléments religieux et
criminels qui créent, selon Komar, la similitude entre l’Amérique d’origine et
la Russie d’aujourd’hui.
 |
| "Sources et perspectives de l'art contemporain russe", ENSBA 2017 |
De son côté, Piotr Pavlenski revendique à son tour
l’héritage de l’Expositon bulldozer qui aurait permis à l’art de passer outre
la propagande et les fonctions décoratives. Celui qui en 2012 s’était cousu des
lèvres avec du fil rouge en soutien aux membres du collectif Pussy Riot, assume
sa confrontation permanente avec le
pouvoir qui veut le désigner comme un criminel ou un fou. Mais de façon
paradoxale, le pouvoir lui-même donne un sens supplémentaire à son
action : c’est ainsi que les interrogatoires réels se transforment en pièces de théâtre et les
pièces à conviction deviennent les œuvres d’art. Néanmoins, Pavlenski récuse le titre du héros qu’il considère comme
une insulte pour un artiste et un moyen pour le pouvoir de l’instrumentaliser. Ce
mot évoque pour lui Léonid Brejnev, quatre fois héros de l’Union soviétique, ainsi
que les héros du travail socialiste, les mères héroïques ou encore le jeune
pionnier Pavlik Morozov qui avait dénoncé son propre père condamné par la suite
à dix ans de camp. Pourtant, si aux yeux de Pavlenski, les tentatives du
pouvoir russe de le criminaliser lui permettent d’échapper à la posture du héros,
dans la conscience collective, il reste un militant irréconciliable et un
martyre investi d’une mission politique et citoyenne.
 |
| Vitaly Komar et Piotr Pavlenski au Loft Roquette, le 25 février 2017 |
Au final, le débat au Loft Roquette a révélé des différences
profondes entre les deux artistes. Certes, les deux se rejoignent dans leur anticonformisme,
leurs tendances subversives et également dans une approche conceptuelle à l’art
indissociable de la réflexion. Mais ils incarnent deux formes opposées de la
contestation : ludique, ironique, structuraliste et relativiste, pour l’un ;
sérieuse et sacrificielle, pour l’autre. Combattre en s’amusant, à l’aide du
second degré, ou au contraire, cautionner l’intégrité et la gravité de son acte
par un geste autodestructif, voilà deux moyens très distincts d’éviter
l’officialisation et la transformation de l’œuvre en une marchandise comme une
autre. Il reste à espérer que les deux artistes aux parcours remarquables auront une occasion
de poursuivre ce dialogue qui révèle l’un des grands dilemmes de l’art
contemporain.